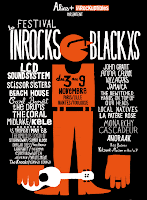Alors que la planète rock est à leurs pieds, qu'ils ont publié au beau milieu de l'été The Suburbs, troisième album en forme de consécration, on attendait en vain ces dernières semaines un passage des Canadiens à Paris. L'impatience se fait d'autant plus ressentir qu'on les a ratés début juillet au Casino de Paris et qu'on a volontairement décidé de ne pas les re-revoir (après 2005 et 2007) à Rock En Seine. Bien nous en a pris, la pluie leur ayant joué un sale tour ce soir-là. Pas d'autre choix donc que de plier bagages et filer chez les gones.
Alors que la planète rock est à leurs pieds, qu'ils ont publié au beau milieu de l'été The Suburbs, troisième album en forme de consécration, on attendait en vain ces dernières semaines un passage des Canadiens à Paris. L'impatience se fait d'autant plus ressentir qu'on les a ratés début juillet au Casino de Paris et qu'on a volontairement décidé de ne pas les re-revoir (après 2005 et 2007) à Rock En Seine. Bien nous en a pris, la pluie leur ayant joué un sale tour ce soir-là. Pas d'autre choix donc que de plier bagages et filer chez les gones.Alors que l'on se faufile dans la fosse de l'immense Halle Tony Garnier (un petit Bercy), on a les pieds qui frétillent. Pourquoi faire tant de cas d'Arcade Fire ? Car dans un contexte rock qui a rarement été aussi morose, il ne reste plus grand monde capable de reprendre le flambeau, et personne ne le fait avec plus de verve qu'eux.
 On se réjouit donc de les voir prendre lentement mais sûrement le chemin des stades (O2 Arena à Londres et Madison Square Garden à New-York remplis à ras-bord). A l'heure où la programmation des grandes arènes se résume à des groupes ayant un pied (voire deux) dans le passé ou aux Muse, Lady Gaga et consorts, et alors que chaque sortie médiatique des Strokes inquiète chaque fois un peu plus, Arcade Fire est en passe de s'imposer comme le plus grand groupe de rock contemporain.
On se réjouit donc de les voir prendre lentement mais sûrement le chemin des stades (O2 Arena à Londres et Madison Square Garden à New-York remplis à ras-bord). A l'heure où la programmation des grandes arènes se résume à des groupes ayant un pied (voire deux) dans le passé ou aux Muse, Lady Gaga et consorts, et alors que chaque sortie médiatique des Strokes inquiète chaque fois un peu plus, Arcade Fire est en passe de s'imposer comme le plus grand groupe de rock contemporain.Ce n'était pourtant pas gagné d'avance : des tronches pas possibles, une musique exigeante et tout sauf soumise aux dictats FM, deux années hors du circuit le temps de se ressourcer, une image arty, une attitude no bullshit. Ils sont résolument à part et c'est ce qui fait leur force : leur vitalité fait tellement de bien dans l'univers ronronnant du rock.
 La curieuse première partie (Fucked Up) nous donne à voir un sacré spécimen. Le chanteur est un beau et costaud bébé velu qui braille, rugit et parfois hurle. Le tout secondé par trois guitaristes et un bassiste qui maltraitent leurs six cordes avec application. Une prestation toute en finesse, en somme.
La curieuse première partie (Fucked Up) nous donne à voir un sacré spécimen. Le chanteur est un beau et costaud bébé velu qui braille, rugit et parfois hurle. Le tout secondé par trois guitaristes et un bassiste qui maltraitent leurs six cordes avec application. Une prestation toute en finesse, en somme.Le frontman-malabar se retrouve la bedaine à l'air dès la fin de la première chanson puis descend dans la fosse serrer des pinces et effrayer le chaland. Le (très bon) groupe se retrouve alors orphelin pour un bon moment, puisque Damian Abraham (c'est son nom) vient faire son show jusqu'au beau milieu du public Aussi épatant que cela puisse être, il en résulte un manque visuel sur scène.
Musicalement, le groupe sonne comme des Brian Jonestown Massacre sous speed et potards à 12. On apprécie malgré l'épuisante voix hardcore du chanteur. On demande surtout à voir ce que donneraient les Fucked Up avec un chant approprié à leur musique. Ils en seraient assurément grandis.
 Montant sur scène au son de "The Suburbs (continued)", Arcade Fire est accueilli comme il se doit : par un déluge de cris et de sifflets. En arrière fond, projeté sur écran géant, un décor d'échangeur autoroutier. La banlieue en arrière-plan, comme un prolongement des récents titres du groupe. Une note de guitare retentit, martelant chaque temps, appuyée par la grosse caisse. Une deuxième vient s'entrelacer avant que la batterie ne fasse s'emballer la machine : "Ready To Start", forcément. Après cette grandiose mise en bouche, The Suburbs est mis de côté au profit de classiques des setlist du groupe : "Keep The Car Running", "Neighborhood #2 (Laïka)", "No Cars Go", "Haïti".
Montant sur scène au son de "The Suburbs (continued)", Arcade Fire est accueilli comme il se doit : par un déluge de cris et de sifflets. En arrière fond, projeté sur écran géant, un décor d'échangeur autoroutier. La banlieue en arrière-plan, comme un prolongement des récents titres du groupe. Une note de guitare retentit, martelant chaque temps, appuyée par la grosse caisse. Une deuxième vient s'entrelacer avant que la batterie ne fasse s'emballer la machine : "Ready To Start", forcément. Après cette grandiose mise en bouche, The Suburbs est mis de côté au profit de classiques des setlist du groupe : "Keep The Car Running", "Neighborhood #2 (Laïka)", "No Cars Go", "Haïti".Pendant une heure et demi, Lyon a droit à un festival de grandes chansons, un véritable feu d'artifice rock. Le groupe est en forme, se déchaîne, donne de la voix, les membres jonglent - comme à l’accoutumée - entre les instruments avec une insolente facilité. Will Butler (frère du chanteur et véritable touche-à-tout) maltraite régulièrement son tambour, le finissant même à coups de poings sur l'orgiaque enchaînement "Neighborhood #3 (Power Out)" / "Rebellion (Lies)". Régine Chassagne (moitié de Win Butler à la ville) mériterait un paragraphe à elle seule : Régine fait de la batterie, Régine joue de l'orgue, Régine chante, Régine agite des rubans de couleur dans tous les sens, Régine joue de l'accordéon, Régine est aux claviers,...
 Avec ces diables de canadiens, il se passe en permanence quelque chose sur scène. Mais, trônant au beau milieu de ce fatras, c'est bel et bien Win Butler qui hypnotise l'assemblée. A première vue, qui aurait parié un kopeck que ce chanteur jadis accoutré comme un croque-mort, plutôt timide et humble hors des planches, deviendrait un jour le chef de meute de la formation la plus passionnante depuis Radiohead ? Pas grand monde. Sauf que sur le champ de bataille, enfilant le costume de prédicateur à l'aura quasi-chamanique, il se révèle en général grandiose.
Avec ces diables de canadiens, il se passe en permanence quelque chose sur scène. Mais, trônant au beau milieu de ce fatras, c'est bel et bien Win Butler qui hypnotise l'assemblée. A première vue, qui aurait parié un kopeck que ce chanteur jadis accoutré comme un croque-mort, plutôt timide et humble hors des planches, deviendrait un jour le chef de meute de la formation la plus passionnante depuis Radiohead ? Pas grand monde. Sauf que sur le champ de bataille, enfilant le costume de prédicateur à l'aura quasi-chamanique, il se révèle en général grandiose.Arcade Fire a de l'or dans les doigts et les cordes vocales : avec eux, un bon morceau devient instantanément un hymne : entre un "No Cars Go" épique, un magnifique "Haïti" au final musclé, un "Month Of May" électrisant, un "Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)" tubesque, "Une Année Sans Lumière" à la fin fin jubilatoire, on ne sait plus où donner de la tête.
 Intensité et énergie, tempo frénétique, envolées grandioses, son massif, telle pourrait être la formule magique d'Arcade Fire. Sauf que perché à l'orgue ("My Body Is A Cage", bonne surprise de la setlist - pas jouée en concert depuis deux ans, prévient le chanteur -, avec le rouquin déjanté Richard Reed Parry à la contrebasse) ou au piano (splendide "The Suburbs"), Win Butler prouve en deux chansons trois mouvements que sa troupe sait aussi faire preuve de subtilité et de douceur.
Intensité et énergie, tempo frénétique, envolées grandioses, son massif, telle pourrait être la formule magique d'Arcade Fire. Sauf que perché à l'orgue ("My Body Is A Cage", bonne surprise de la setlist - pas jouée en concert depuis deux ans, prévient le chanteur -, avec le rouquin déjanté Richard Reed Parry à la contrebasse) ou au piano (splendide "The Suburbs"), Win Butler prouve en deux chansons trois mouvements que sa troupe sait aussi faire preuve de subtilité et de douceur.Les canadiens nous réservent une fin de soirée fabuleuse : "Neighborhood #1 (Tunnels)" (beau à pleurer) et "We Used To Wait" avant le clou de la soirée : "Neighborhood #3 (Power Out)" - enivrante malgré une voix pas très assurée - et "Rebellion (Lies)" se succèdent sans transition, dynamitant tout sur leur passage. En rappel, Lyon a droit à "Intervention" - un peu pompier mais diablement efficace - et l'incontournable "Wake Up", qui finit de nous achever les cordes vocales.
 Avec une setlist centrée sur Funeral et The Suburbs et une générosité admirable dans l'effort, Arcade Fire a livré en cette fraîche soirée lyonnaise un concert pas parfait mais presque. La faute à un son certes puissant mais manquant de relief, de profondeur. On a aussi senti quelques pointes de fatigue dans la voix de Win Butler. Enfin, on ne peut que regretter de ne pas avoir entendu résonner "Empty Rooms" et "Deep Blue" dans la halle Tony Garnier.
Avec une setlist centrée sur Funeral et The Suburbs et une générosité admirable dans l'effort, Arcade Fire a livré en cette fraîche soirée lyonnaise un concert pas parfait mais presque. La faute à un son certes puissant mais manquant de relief, de profondeur. On a aussi senti quelques pointes de fatigue dans la voix de Win Butler. Enfin, on ne peut que regretter de ne pas avoir entendu résonner "Empty Rooms" et "Deep Blue" dans la halle Tony Garnier.Parmi des dizaines d'autres raisons, on sera éternellement reconnaissant à Arcade Fire pour avoir décomplexé tous les chanteurs en herbe. Car à un concert des canadiens, on chante sans retenue ni arrière-pensée des refrains exaltants, créant une pulsion libératrice commune à tous les spectateurs. On est à mi-chemin entre les choeurs de l'armée rouge version rock et la bande de marins de retour sur la terre ferme. Quoi qu'il en soit, après avoir beuglé tout notre saoul la pléiade de refrains magnifiques proposés ce soir, on ressort de la Halle Tony Garnier trempé de sueur et ivre de bonheur.
Set-list Arcade Fire : Intro The Suburbs (continued), 01 Ready To Start, 02 Keep The Car Running, 03 Neighborhood #2 (Laïka), 04 No Cars Go, 05 Haïti, 06 Sprawl II (Mountains Beyond Mountains), 07 Rococo, 08 Une Année Sans Lumière, 09 My Body Is A Cage, 10 The Suburbs, 11 Month Of May, 12 Neighborhood #1 (Tunnels), 13 We Used To Wait, 14 Neighborhood #3 (Power Out), 15 Rebellion (Lies) / Rappel / 16 Intervention, 17 Wake Up

 La dernière fois que l'on a vu
La dernière fois que l'on a vu